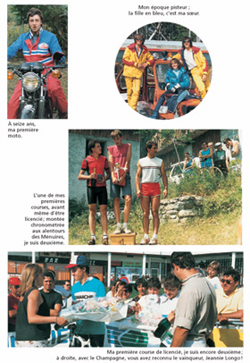| |
| Préface de Jacques Balutin |
|
Si j'ai accepté de préfacer ce livre, c'est simplement
parce que Thierry Bourguignon est un ami. Outre notre passion pour le
vélo, nous avons quelques points communs.
Comme lui, j'ai commencé très tard (lui à 23 ans,
moi à 38).
Comme lui, je tombe énormément ; la dernière chute,
en moto cette fois, a failli être la dernière.
Comme lui, j'adore les descentes (ce sont les montées qui précèdent
que je n'aime pas du tout !).
J'ai commencé le vélo très tard car je pratiquais
la course à pied avant que cela ne s'appelle du "jogging".
Je souffrais énormément du dos et mon médecin m'ordonna
d'arrêter ce sport et de me mettre au vélo de course.
Et voilà comment je me suis retrouvé roulant autour de
l'hippodrome de Longchamp dans le bois de Boulogne. J'avais déniché
un vieux vélo à la cave, un short et des baskets, et vogue
la galère. Au bout de deux tours de circuit, soit sept kilomètres
deux cents, j'étais à l'agonie. Un jeune coureur amateur
qui passait par là me reconnut et eut pitié de moi : "Ce
n'est pas un vélo que vous avez là, c'est un fer à
repasser." Il m'emmena sur le champ chez un vieux marchand de vélos,
Monsieur Leroy, qui n'était autre que le président de l'ACBB,
un des plus grands clubs amateurs de la région parisienne. Ce fut
lui qui réalisa ma première bicyclette sur mesure et me
prodigua les premiers conseils.
En effet, peu de gens savent que le vélo est un sport qui doit
s'apprendre. Ayant tous eu un vélo étant enfant, nous pensons
qu'il suffit de pédaler. Grosse erreur, et moi qui n'ai jamais
pratiqué la compétition, au bout de vingt ans, j'apprends
toujours.
Donc, premier vélo, joie de découvrir du beau matériel,
premières sorties sur la route et premiers copains cyclistes.
L'amitié joue un grand rôle dans ce sport. C'est un monde
simple, sans bluff, et il faut être d'une grande humilité.
Il y a toujours quelqu'un de meilleur que vous, un jour ou l'autre. En
vélo, on ne peut pas tricher, il faut pédaler, et, comme
disait Antoine Blondin : "Tu ne peux pas monter le mont Ventoux en
play-back."
Bénéficiant d'une petite notoriété, j'ai
eu la chance d'approcher de grands champions : Hinault, Thévenet,
Merckx, Lemond, eh bien ils étaient tous d'une simplicité,
d'une gentillesse qui réchauffait le cœur.
Je connaissais Thierry de nom, mais je ne l'avais jamais côtoyé.
Notre première rencontre eut lieu sur le Téléthon
Le Mont-Saint-Michel-Paris. Michel Drucker m'avait demandé de l'accompagner
et j'avais accepté. Thierry était là avec quelques
autres professionnels, Éric Boyer, Thierry Marie, etc. Ce sont
eux qui nous ouvraient la route. La première nuit fut joyeuse et
sans histoire. Le lendemain, nous avions 360 kilomètres à
effectuer et, à l'allure du facteur qui était la nôtre,
nous sommes restés environ seize heures en selle. Ce fut ce deuxième
soir que j'entendis Bourgui protester fermement : "C'est bientôt
fini votre plaisanterie" ; "Vous êtes perdus ou quoi !"
; "Y'en a marre" ; etc, etc. Il faut dire qu'en fin de parcours
nous nous étions retrouvés à 23 heures sur une autoroute,
sans voiture d'accompagnement ; Thierry n'avait pas tort de gueuler, lui
qui aurait accompli cette distance en neuf-dix heures !
L'année dernière, l'ostéopathe de l'équipe
BigMat Auber 93 me demanda si je voulais être le parrain de l'équipe.
Je les connaissais un peu, ayant eu l'occasion de rouler avec eux lors
d'une sortie organisée par Stéphane Javalet, le manager,
au profit de la myopathie. C'est une bande de jeunes dynamiques, pleins
de talent et d'espoir. Thierry étant capitaine de route, j'ai accepté.
L'avantage d'être parrain, c'est qu'il faut suivre les courses.
En 1999, je suis donc resté deux jours sur Paris-Nice, puis j'ai
vécu les deux plus belles étapes du Tour de France, dans
les Alpes. Je pense que cette étape du 14 juillet restera longtemps
dans les mémoires. À la faveur d'une descente, son point
fort, Thierry en profita pour fausser compagnie au peloton. Accompagné
par Stéphane Heulot, il nous offrit une échappée
de plus de 150 kilomètres. Cet exploit, ajouté à
son émission de télé, fit fleurir des banderoles
au bord des routes "Allez Bourgui" jusqu'à la fin du
Tour ; et nous les reverrons cette année !
Le parrain est aussi invité à la fiesta qui clôt
le Tour. Toute la famille Bourguignon était là, et tous
les amis de Thierry, et ça fait du monde. Le matin, petite sortie
cyclotouriste avec Papa, Maman et les volontaires. Puis la fête,
jusqu'à très tard dans la nuit, et là, croyez-moi,
pour suivre Thierry, il faut être costaud.
Je ne veux rien vous dire de plus sur Bourgui, car vous allez le découvrir
dans ce livre. Sachez seulement que vous allez pénétrer
dans le monde du cyclisme accompagné par un grand professionnel.
Il est aujourd'hui un des plus anciens du peloton, c'est un sage. Il a
couru avec les plus grands, il les a aidés dans leur carrière.
Il va vous faire visiter les coulisses du vélo, sans rien vous
cacher, sans rien omettre.
Si vous êtes cycliste, vous allez vous régaler avec toutes
ces aventures dans le peloton. Si vous n'avez jamais touché un
vélo, vous allez découvrir un des sports les plus durs.
Je ne crois pas qu'il existe un sport où l'on souffre autant que
sur un vélo. J'ai vu de grands champions pleurer de douleur en
escaladant un col, et ne pas poser pied à terre. Ce sont des surhommes,
des extra-terrestres, et Thierry en fait partie.
Jacques Balutin |
|
| Chapitre un |
| Il n'y a que la victoire qui compte |
— Dis, gamin, tu te crois où ? Chez les cadets ? À
la kermesse du village ? Ici, c'est le Tour de France ! Tu m'entends ?
Le TOUR DE FRANCE !
Cela se passait en 1991 ; ma deuxième année de coureur
professionnel avec l'équipe Toshiba, mon premier Tour de France,
la fameuse étape de l'Alpe-d'Huez. J'avais attaqué dans
la côte du Motty, à 90 kilomètres de l'arrivée.
Marc Durant, mon directeur sportif adjoint, avait porté sa voiture à ma hauteur, et il me faisait savoir sa façon de penser...
— B... de m... ! qu'est-ce que je t'ai dit il y a dix minutes ? Tu es dans le groupe de tête, c'est bien. Alors, tu ne donnes
pas un coup de pédale de plus que les autres. Tu collabores loyalement,
d'accord, mais surtout tu ne te montres pas. Et toi, qu'est-ce que tu
m'inventes ? Une sortie en pleine bagarre ! B… de m… ! tu
vas exploser, c'est sûr. Qui sont-ils, ceux qui sont derrière
? Les meilleurs coureurs du monde ! Ils vont te dévorer en rigolant,
ils vont...
Je me suis relevé. Pourtant, ce jour-là, j'étais
fort, dans cette région d'Isère où j'ai toujours
vécu, sur ces routes que je pourrais monter les yeux fermés
tellement je m'y suis entraîné, devant mon public, devant
mes parents que j'avais aperçus sur le palier de leur maison quand
la course avait traversé notre village.
J'ai roulé avec l'échappée. Quand Pedro Ruiz Cabestani,
un grimpeur espagnol, a attaqué à 70 kilomètres de
l'arrivée, j'ai été le seul à l'accompagner.
Les premiers lacets de l'ascension de l'Alpe-d'Huez, nous ne les avons
pas attaqués à fond, de façon à garder des
forces pour le final. Le groupe Maillot jaune, emmené à
toute allure par Jean-François Bernard pour son leader Miguel Indurain,
nous a rejoints assez tôt. J'ai été lâché.
Le cœur n'y était plus, et j'ai terminé à mon train
pour finir dans les trentièmes de l'étape. Peut-être,
si on m'avait laissé tenter ma chance de loin, si j'avais pu prendre
assez d'avance, qui sait...
Ce que Marc Durant ignorait, c'est que, au moment où il me passait
son savon, la caméra nous filmait, et le micro était ouvert.
Je l'avais remarqué, et cela me faisait rire, mais un peu jaune.
Cette engueulade, dont j'ai un peu enjolivé la forme mais rien
changé au fond, des millions de téléspectateurs l'ont
entendue en direct. Thierry Bourguignon, qui jusqu'alors n'était
connu que d'une poignée de spécialistes, a été
révélé au grand public sous un torrent d'invectives.
Le lendemain, date de l'une de mes plus belles performances de cycliste
professionnel, il n'y avait plus ni micro ni caméra. Il pleuvait
tant que les relais de la télévision étaient en panne.
Pas d'images. Si je vous raconte que je n'ai pas eu que de la chance dans
ma vie, vous commencez à me croire ?
Le lendemain, c'était l'étape Bourg-d'Oisans-Morzine.
La plus dure des Alpes ; la plus dure de la Grande Boucle ; la plus dure
de l'année. Quelques semaines avant le Tour, chaque participant
reçoit des organisateurs un grand livre, où chaque étape
est présentée avec de jolies cartes et tous les détails
du parcours. Certains coureurs le feuillettent à peine. D'autres
le potassent jusqu'à pouvoir en réciter des passages entiers.
Mais, tous, quand ils tombent sur les pages décrivant une étape
comme Bourg-d'Oisans-Morzine, sont saisis d'un mouvement de recul. Ils
écarquillent les yeux. Ils énumèrent dans leur tête
: montée de l'Arly (3e catégorie*), col des Aravis (1ère
catégorie), col de la Colombière (1ère catégorie),
col de la Joux-Plane (hors catégorie). Un menu de gala ; le 31
décembre des coureurs cyclistes. Même le plus costaud des
grimpeurs sait qu'il devra rester autour de sept heures sur le vélo,
dont au moins trois heures d'escalade, et il n'ose pas imaginer dans quel
état il se trouvera à l'approche de la dernière difficulté.
Peu avant le départ, à la séance de signature
sur un podium, l'équivalent de l'appel pour les écoliers,
Daniel Mangeas, le speaker officiel du Tour de France, étonnant
sosie du chanteur Pierre Bachelet, m'a tendu le micro devant la masse
des badauds :
— Ah ! Thierry Bourguignon, formidable votre numéro d'hier
dans l'étape de l'Alpe-d'Huez ! Alors aujourd'hui, à quoi
pensez-vous ?
— À refaire la même chose, voire mieux, ai-je répondu
sur le ton de la plaisanterie.
Au risque de décevoir, sur une course pareille, il n'y a pas
grand chose à raconter. Généralement, la première
heure est tranquille. Le peloton s'éveille doucement. On s'échauffe.
On est à l'écoute de son corps, avec appréhension.
Ensuite, c'est sauve qui peut. Pas de stratégie. Chacun suit tant
qu'il peut suivre. C'est tout. Le traditionnel "briefing" du
matin, durant lequel le directeur sportif décortique sa tactique
sophistiquée, expose ses consignes savantes, dure à peine
cinq minutes : "Bon, les gars, ça va être sévère,
alors accrochez-vous..." On n'a pas besoin d'en entendre plus. Dans
les équipes qui défendent un leader, c'est un peu différent.
Les équipiers vont se sacrifier les uns après les autres
afin de protéger leur chef de file, l'amener le plus loin possible.
Mais, en 1991, chez Toshiba, nous n'avions pas de leader. Le Suisse Toni
Rominger, notre champion, était devant sa télévision,
blessé au genou. Avec les deux frères Madiot, Denis Roux,
et un petit débutant, Laurent Jalabert, nous formions une équipe
de baroudeurs. Nous étions là pour essayer de nous montrer,
éventuellement accrocher une étape, mais sans espoir au
classement général. Donc sauve qui peut !
Durant les deux premières heures, j'ai traîné mes
courbatures de la veille : un mauvais coup de pédale, des douleurs
un peu partout. Et puis, au fur et mesure, la forme est revenue. J'étais
dernier du peloton. Je voyais l'avant-dernier flancher. Je faisais l'effort
pour recoller. De cette manière, après avoir vu sauter 80
% des coureurs les uns à la suite des autres, j'ai abordé
le col de la Colombières, à 65 kilomètres de l'arrivée,
dans le groupe d'une trentaine de rescapés autour du Maillot jaune.
Sous la pluie battante, je préférais aborder la descente
en tête. Je me suis fait violence afin de franchir le sommet en
première position. Après une quinzaine de kilomètres
de descente, notre groupe, composé d'une dizaine de coureurs, dont
Miguel Indurain, Gianni Bugno, Greg Lemond et Charly Mottet, a tourné
à fond dans la vallée. Il fallait reprendre le plus de temps
possible sur la tête de la course, une échappée de
cinq ou six grimpeurs : Colombiens, Italiens, Espagnols, et le Français
Thierry Claveyrolat ; ils avaient une minute trente d'avance environ.
Après Cluses, l'Espagnol Pedro Ruiz Cabestani est sorti de notre
groupe, à la faveur d'une petite bosse, en contre après
une attaque avortée de Laurent Fignon. Je me suis dit : "Toute
la journée d'hier, je l'ai passée avec lui, ce n'est pas
aujourd'hui qu'il va partir sans moi." J'ai réussi à
lui emboîter le pas. Tous les deux, nous sommes revenus sur l'échappée,
au pied du col de la Joux-Plane, la dernière monstruosité
de la journée, à 25 kilomètres de l'arrivée.
Dès les premiers lacets, il y eut des escarmouches, les grimpeurs
tentant de s'intimider entre eux. Après avoir contrôlé
les préambules, j'ai placé une accélération.
Un à un, j'ai récupéré puis dépassé
tous les grimpeurs éparpillés. Cette fois, j'étais
seul en tête. Une émotion m'envahit soudain : cette étape,
je peux la gagner !
Vers le milieu de l'ascension, Thierry Claveyrolat m'a rejoint. Plus
âgé que moi, Thierry était un professionnel confirmé.
Les journalistes l'avaient surnommé l'Aigle de Vizille, son village
natal, en référence à Federico Bahamontes, l'Aigle
de Tolède, roi de la montagne, grand champion espagnol des années
60. Le rapprochement n'avait rien d'ironique. Petit gabarit, tout en nerfs
et en muscles, Thierry était ce que l'on appelle un pur grimpeur.
Une race à part : le pur grimpeur, il monte par une succession
d'accélérations ; des sauts de puce, foudroyants, irrationnels.
Quand ces phénomènes vous décochent un de leurs décollages,
il est toujours incroyablement impressionnant de les voir gagner des dizaines
de mètres en quelques secondes ; puis ils adoptent un tempo normal
; et ils redémarrent un peu plus loin. Moi, je suis un bon grimpeur,
mais d'une espèce beaucoup plus ordinaire. Je monte au train. Je
trouve un rythme au pied du col, et je m'efforce de le garder, si possible
en accélérant très progressivement. Si tout va bien,
je suis un peu plus rapide au sommet qu'au départ. Même longs
et difficiles, les cols réguliers me réussissent bien. La
plupart de mes victoires, je les ai remportées sur ce type de parcours.
En revanche, si la pente est variée, chaotique, j'apprécie
moins.
À peine m'avait-il rejoint, Clavette, comme on le surnommait
dans le peloton, me gratifia d'une envolée dont il avait le secret.
Son objectif était de me lâcher, mais aussi de me démoraliser.
Dans ces cas-là, ne pas essayer de suivre ; garder le rythme ;
s'appliquer ; gérer l'écart ; surtout ne pas s'affoler.
Ainsi, je parvins au sommet avec une vingtaine de secondes de retard,
pas plus. Je connaissais la fin du parcours : 10 kilomètres de
descente, puis 5 kilomètres de faux plat montant jusqu'à
Morzine. Si je ne parvenais pas à récupérer Clavette
dans la descente, la course était perdue. |
|
[ suite dans le livre : 14 pages… ] |
|
| Chapitre deux |
| Ce ne peut pas être lui |
J'ai découvert le cyclisme de compétition très
tard. À 23 ans, en 1986. Je travaillais comme pisteur-secouriste
à la station des Ménuires pendant la saison d'hiver, de
décembre à mai, et comme ouvrier forestier pour un organisme
d'État, pendant la saison d'été, de mai à
novembre. Aux Ménuires, parmi les animations de l'été,
une course de vélo était organisée au mois de juillet
: elle durait une semaine, sur des parcours aux alentours de la station.
C'était un peu comme une course par étapes, avec chaque
jour différents classements. La plupart des pisteurs participaient
à cette petite compétition, dénommée le Tour
des Belleville. Au printemps, quand la route était praticable,
tout le monde allait s'entraîner en vue du grand défi estival.
L'épreuve excitait les conversations : Untel avait bouclé
tel parcours en moins de trente minutes ; Untel venait de s'acheter un
vélo ultra léger afin de mettre toutes les chances de son
côté. Entendre parler du Tour des Belleville à longueur
de journée, j'en avais par-dessus la tête. Un soir, j'ai
déclaré à des copains : "C'est décidé,
je m'achète une bicyclette, et vous verrez, l'année prochaine,
je vous mets une volée." La joyeuse assemblée en fut
secouée de rires.
Comme tous les gamins de la campagne, j'avais roulé en vélo
pendant toute mon enfance. S'il fallait aller visiter un ami à
5, 10, 15 kilomètres, j'enfourchai ma bicyclette. Les grandes virées
le dimanche avec deux ou trois copains, les montées à se
faire éclater le cœur, les descentes à fond de train, les
sprints frénétiques figurent en bonne place dans la galerie
de mes souvenirs de petit garçon. Quand j'avais treize ou quatorze
ans, un ami de la famille, qui obtenait d'honorables résultats
dans les compétitions d'amateurs, m'avait emmené en balade.
Au retour, il avait affirmé à mon père que j'avais
des aptitudes ; il l'avait incité à m'inscrire au club de
La Mure, à moins de 15 kilomètres de notre village. Mais,
à cet âge, la compétition dans un cadre officiel ne
m'attirait pas du tout. J'aimais bien le sport ; en dehors des balades
à vélo, il m'arrivait de courir, de jouer au football, et
surtout de skier durant des week-ends entiers. Mais c'était pour
le plaisir, pour le “fun”, sans contrainte. Et puis, même
si je regardais le Tour de France à la télévision,
même si parfois je me déplaçais au bord des routes
pour les belles étapes de montagne dans ma région, à
cette époque, c'étaient les motos qui me faisaient rêver,
beaucoup plus que le vélo. Quant au sport au lycée, il m'ennuyait
au plus haut point. Sous prétexte de légers pincements au
cœur, dus à une nervosité excessive, j'avais été
dispensé d'éducation physique pendant deux ans, en première
et en terminale.
Entre quinze et vingt ans, jusqu'au début de ma vie professionnelle
à la montagne, j'étais "hard-rock". Pour mes copains
et moi, ACDC, Scorpion, Trust, Led Zeppelin, Deep Purple représentaient
l'unique musique écoutable, pour ne pas dire l'unique musique qui
existât. Sur le modèle des couvertures des disques, dont
je possédais une assez belle collection, nous nous laissions pousser
les cheveux sur les épaules, nous portions des jeans troués
et des bottines à bout pointu ; nos motos trafiquées étaient
ornées de peintures de tête de mort, de cornes de vache.
Nous buvions de temps en temps. Vu notre allure, dans mon village d'Entraigues,
200 habitants, on nous appelait "les drogués". Ma mère,
femme au foyer avec trois enfants, mon père, artisan ébéniste
comme son père et son frère, constataient la violence de
ma révolte d'adolescent, mon manque de motivation pour des études
qui s'achevèrent par un échec au bac technique.
Des amis m'avaient recommandé un vieux marchand de vélos
à Eychirolles (je n'ai pas pu retrouver son nom), qui fabriquait
lui-même des cadres sur mesure, pour un prix raisonnable. Tubes
Reynolds, équipements Campagnolo, belle couleur verte, mon matériel
était flambant neuf au départ de ma première course
cyclotouriste, début 1986. Dès la première ascension,
j'ai dépassé la masse des participants. Sans entraînement,
alors qu'une semaine auparavant je fumais encore ma dizaine de cigarettes
quotidiennes, j'ai terminé dans les premiers, avec en prime un
prix en nature, du genre boîte à outils offerte par la grande
surface du coin. Beaucoup plus important, j'avais découvert le
plaisir du vélo. Dès la semaine suivante, je m'inscrivai
à une autre épreuve, pour un résultat également
encourageant. Durant l'hiver et le printemps 1986, j'ai disputé
une dizaine de compétitions cyclosportives, avec quelques victoires.
Le vieux marchand de vélos, que je visitais régulièrement
afin d'acheter pneus et autres accessoires, négociait âprement
les réductions que j'essayais d'obtenir, car il était assez
près de ses sous ; mais il observait mes débuts avec sympathie
:
— Thierry, il me semble que tu as des dispositions. Tu devrais
prendre une licence à la Fédération française
de cyclisme et t'inscrire dans un club. Si tu veux, j'en parle à
un ami, M. Cornier, président du club de Vizille. C'est une structure
très familiale, je suis sûr que ça te plaira. Tu pourras
progresser dans ton classement. En plus, tu auras la possibilité
de prendre part à des courses où les prix sont en espèces,
pas seulement en nature.
Ainsi, en août 1986, quelques mois après avoir commencé
le vélo, j'ai signé une licence d'amateur. La bicyclette
achetée à Eychirolles est la seule que j'aie payée
de ma vie, car ensuite le matériel m'a été fourni
par les clubs d'amateurs, puis par les équipes professionnelles
auxquelles j'ai appartenu. Mes parents la conservent toujours, un peu
rouillée, dans leur garage. Ma mère l'utilise parfois.
Ma première course de licencié, j'aurais du mal à
l'oublier. C'était en août 1986, à Chamrousse, sur
un circuit difficile comprenant une côte de quatrième catégorie.
Il y avait une quinzaine de tours à effectuer. Dépourvu
de la moindre notion de tactique, je suis parti comme une fusée.
Au douzième passage, j'avais pris un tour au peloton. Mais j'étais
épuisé. Peu importe, me suis-je dit, j'ai assez d'avance
pour terminer en tête, même en roulant arrêté.
À deux tours de l'arrivée, un coureur m'a rejoint. Quand
il est arrivé à ma hauteur, j'ai jeté un coup d'œil
machinal pour l'apercevoir. Je vis des formes sous le maillot. Interloqué,
j'ai regardé son visage : c'était une femme ! Jeannie Longo
! Habitant dans la région, elle s'était inscrite à
cette compétition subalterne afin de se dégourdir les jambes,
entre le Tour de France féminin, qu'elle venait de gagner, et le
championnat du monde, qu'elle allait gagner. Après m'avoir accompagné
pendant les deux derniers tours, histoire de s'assurer que j'étais
bel et bien cuit, les cuisses parcourues de crampes, dures comme de la
fonte, sans rémission possible, elle m'a déposé dans
le sprint final. Sur le podium, le troisième, aussi abîmé
que je l'étais, et moi-même étions partagés
entre deux sentiments : la satisfaction d'une bonne performance pour notre
niveau, et le ridicule, quand même, d'avoir été battus
par une femme. Il est vrai que seule Jeannie Longo était capable
d'un tel exploit. |
|
[ suite dans le livre : 14 pages… ] |
|
| Chapitre trois |
| Le ressuscité |
Au milieu de la route, une voiture à moitié défoncée.
Dispersés à droite et à gauche, des vélos
cassés. Des coureurs déchirés de partout, grimaçants,
qui se tordent en frottant leurs plaies. Par le bas-côté,
il faut contourner les obstacles, en portant son vélo. On jette
un coup d'œil aux blessés, on murmure des "ça va ?"
sur un ton réconfortant. Derrière la carcasse de la voiture,
un cycliste est inanimé sur la chaussée. Deux ou trois personnes
s'agitent autour de lui, sans savoir ce qu'il faudrait faire. Il saigne
de la tête. Le sang est dilué dans la pluie, entraîné
par la pente. Une rivière rouge ! La petite route qui descend
est devenue une rivière rouge, qui s'engouffre dans le brouillard.
Les coureurs se savent inutiles pour porter secours ; ils n'ont qu'une
volonté : fuir ce spectacle. Certains font demi-tour, se heurtant
au flot des concurrents qui les suivent, qui n'ont pas encore compris.
D'autres s'échappent par la descente ; ils pédalent dans
le mélange de sang et d'eau, et on voit leurs mollets se couvrir
d'éclaboussures écarlates. Cette scène, qui a traumatisé
la plupart des témoins, qui a provoqué des cauchemars chez
certains, on me l'a racontée. Je ne l'ai pas vue, et pourtant j'y
tenais le premier rôle. C'était mon accident.
Ce jour-là, en février 1989, il pleuvait des seaux d'eau
glacée. La course à laquelle j'étais inscrit, le
grand prix de La Ciotat, est une belle épreuve amateur de première
catégorie, avec les meilleurs Français et de nombreux étrangers.
Ce qui rétrospectivement est un peu bizarre, c'est que j'aurais
dû ne pas y participer. La Fédération avait oublié
d'envoyer ma licence, ou j'avais négligé de la réclamer,
toujours est-il que je n'étais pas en règle. Les commissaires
m'interdirent de prendre le départ. Il m'a fallu parlementer :
"Mais enfin, vous voyez bien, je suis ici avec l'équipe de
France ; s'ils me sélectionnent, c'est que ma licence est à
jour, quand même ; d'ailleurs, vous pouvez demander à M.
Michel Thèze, mon directeur sportif." Au bout d'une demi-heure
de palabres et d'énervement, ils finirent par céder.
D'après ce qui m'a été rapporté (car moi,
je ne me rappelle de rien, pas même de ce qui s'est passé
avant le choc, pas même du temps qu'il faisait), je devais me sentir
en forme. Après deux ou trois tours de circuit, j'imagine que je
grelottais de froid, comme tout le monde. Mais j'étais bien décidé
à leur faire mal. J'avais repéré une descente pas
réellement dangereuse, mais sinueuse et technique. J'ai lancé
une échappée avec cinq ou six coureurs. De cette manière,
j'obligeais le peloton à attaquer la descente à fond, afin
de ne pas accentuer son retard. Je savais que, sous le déluge,
ils allaient se faire un peu peur, frotter, s'énerver les uns contre
les autres. Même s'ils parvenaient à nous rejoindre un peu
plus tard, c'était toujours ça de gagné. Et puis,
à la sortie d'un virage, alors que la route était fermée
à la circulation, une voiture a débouché devant nous.
L'échappée n'a même pas eu le temps de freiner. Badaboum
! Ma tête est allée s'encastrer dans un vélo. Le pédalier
m'a entaillé le crâne, sur 9 cm, comme un coup de scie. Et
voilà ! C'était ma troisième course après
ma décision de me consacrer entièrement au vélo pendant
un an afin d'essayer de devenir professionnel. Et je me retrouvais le
nez dans le bitume, dans le coma. Pour la pire galère de ma vie.
Prévenu par le système radio de l'organisateur, le Samu
est arrivé rapidement. Ils m'ont emmené à l'hôpital
de La Ciotat. Devant la gravité de mon état, les médecins
m'expédièrent aussitôt par hélicoptère
à l'hôpital de a Timone, à Marseille, qui dispose
d'un service spécialisé dans la réanimation. Par
un autre hasard un peu curieux, le médecin du Samu qui m'a accompagné
durant le voyage était une connaissance de ma future épouse.
Quelques années plus tard, elle est tombée en face de moi,
lors d'une soirée. Quand elle m'a reconnu, elle n'en revenait pas : "Franchement, je te croyais mort. Je n'aurais pas parié
un centime sur tes chances de survie." Les pontes de la Timone me
trépanèrent immédiatement, afin d'évacuer
la masse de sang qui comprimait mon cerveau. Michel Thèze eut la
mission de prévenir mes parents. Quand ceux-ci arrivèrent
à l'hôpital, au milieu de la nuit, ils furent accueillis
par des paroles gênées et compatissantes : "Si on vous
laisse le voir, c'est qu'il risque de décéder cette nuit."
Mon visage était tellement enflé, déformé,
que mon père ne put me reconnaître. Une machine était
branchée sur mon crâne pour résorber l'œdème.
J'étais couvert de fils, sondé de partout.
Sans doute, ce soir-là, la Faucheuse s'est penchée à
mon chevet. Elle m'a regardé, et ne m'a pas voulu : "Toi,
retourne d'où tu viens, ce n'est pas encore le moment." Et
puis, comme j'ai l'habitude de le dire, la mauvaise herbe, on ne l'extermine
pas si facilement. Le matin, j'étais toujours en vie. Mais les
médecins tempérèrent la joie de mes parents : "Il
a passé le plus dur, bravo pour la belle santé que vous
lui avez donnée, il va probablement survivre, mais il sera peut-être
paralysé." Quelques jours plus tard, le pronostic se faisait
plus favorable : "Il va remarcher, c'est sûr, mais ne vous
emballez pas, d'autres séquelles sont possibles, il faut attendre."
Avec une compétence rare, les médecins contrôlaient
patiemment ma remontée vers la surface. Du coma 4, le plus profond,
ils m'emmenèrent au coma 3, puis 2, puis 1. Au douzième
jour, les infirmières se précipitaient dans ma chambre,
averties par des alarmes. Dans un mélange de gaieté et d'affolement,
elles découvraient un énergumène gesticulant, arrachant
ses sondes et criant qu'il voulait se lever, qu'il voulait sortir. |
|
[ suite dans le livre : 18 pages… ] |
|
| Chapitre quatre |
| Un autre monde |
— Maintenant, tu entres dans un nouveau monde. Tu oublies ton
palmarès. Tu oublies ce que tu sais. Tu recommences à zéro.
Ce ne sont pas forcément les meilleurs amateurs qui font les meilleurs
professionnels. Ici, tout est différent.
Ces propos furent les premières paroles que prononça
Yves Hézard, le directeur sportif de Toshiba, quand j'arrivai dans
son équipe en octobre 1989. Laissez-moi, si cela vous amuse, vous
emmener à la découverte d'une formation professionnelle.
Une visite de l'arrière, en quelque sorte.
Une équipe professionnelle, c'est d'abord une petite entreprise.
Le personnel permanent comprend un manager général-directeur
sportif, d'ordinaire deux directeurs sportifs adjoints, un médecin,
trois ou quatre soigneurs, trois ou quatre mécanos, une secrétaire,
parfois un responsable des relations publiques. Des soigneurs et mécanos
supplémentaires sont employés “à la pige”
pour les grandes courses. Du leader au néo-pro, une petite vingtaine
de coureurs sont sous contrat.
Le manager général-directeur sportif est le patron de
l'équipe. Il sélectionne les coureurs et l'encadrement.
Il cherche les sponsors. Il établit le calendrier. Il opère
les principaux choix tactiques pendant les courses importantes. Il stimule
les uns et les autres. Ce poste réclame de nombreuses compétences
: technicien du cyclisme, meneur, gestionnaire, voire homme d'affaires.
Rares sont les perles qui réunissent autant de qualités
différentes. J'ai connu des tacticiens miraculeux : ils soupèsent
tous les paramètres d'une course, le parcours, la météo,
les forces en présence, la forme des uns et des autres ; sur la
carte, ils désignent du doigt les endroits stratégiques,
là où la décision risque de se jouer ; ils prédisent
différents scénarios pour le déroulement de l'épreuve
; pendant la course, ils savent à chaque instant ce qu'il faut
faire, ou ne pas faire. En les écoutant, vous ne travaillez que
lorsque cela est absolument nécessaire, et vos attaques font toujours
mal à l'adversaire. Mais ces génies sont parfois de piètres
animateurs. Les conflits qui surgissent dans l'équipe, simplement
parce que les hommes sont les hommes, s'enveniment insidieusement, jusqu'à
pourrir l'atmosphère et peser sur les résultats. Inversement,
j'ai connu des psychologues magiques, qui auraient fait rouler un cul-de-jatte,
qui auraient fait coopérer deux ennemis mortels, mais ne comprenant
pas grand chose à ce qui se passe pendant une course, ou incapables
de dégoter un sponsor. En somme, le directeur sportif idéal
n'existe pas, ce qui n'a rien d'étonnant en ce bas monde.
Les directeurs sportifs adjoints assistent le manager général,
relaient ses consignes auprès des coureurs, suivent les entraînements.
Il est fréquent qu'une équipe soit inscrite à deux
courses différentes le même jour. Alors la formation se scinde,
par exemple huit coureurs d'un côté et sept de l'autre, et
l'un des adjoints prend la responsabilité de l'un des deux groupes.
Certains adjoints ont les capacités et l'ambition de se retrouver
un jour à la tête d'une équipe ; chez d'autres, le
seul talent apparent est de savoir doubler un peloton sans écraser
les coureurs. Je ne citerai pas de nom, mais il m'est arrivé de
rencontrer des “chauffeurs de voiture”, comme on dit.
Le médecin ? J'ai entendu déclarer que, dans le cyclisme
“moderne”, il est devenu un personnage plus important que
le directeur sportif... Je ne veux pas entrer ici dans ce pénible
débat ; le dopage fait l'objet d'un prochain chapitre. Ce que je
peux affirmer, c'est que, au sein des équipes où j'ai été
employé, les médecins étaient à ma connaissance
de véritables médecins : ils étaient là pour
nous guérir quand nous étions souffrants. Point. Et le travail
ne manque pas : d'une part, les chutes sont fréquentes ; d'autre
part, les athlètes de haut niveau sont des petits êtres fragiles
: problèmes musculaires divers, grippes, rhumes, allergies variées,
difficultés intestinales, etc. Je ne me souviens pas avoir disputé
un seul de mes sept Tours de France sans avoir été malade
pendant au moins deux ou trois jours, principalement à cause de
mes allergies au pollen et à quelques produits polluants. Même
s'il conserve presque toujours une clientèle extérieure,
le médecin consacre une bonne partie de son temps à l'équipe.
L'équipe BigMat Auber 93, qui est la mienne depuis quelques
années, fut l'une des premières, sinon la première,
à faire appel aux talents d'un ostéopathe. Ce sorcier est
plein d'une science mystérieuse. Par exemple, si vous venez le
voir en vous plaignant du dos, il vous palpe le crane, et décrète
que vos douleurs vertébrales proviennent d'un début de bronchite
; il vous envoie soigner votre poumon ; et ça marche. L'ostéopathie
considère que la plupart des problèmes de "dur"
(les os, les muscles) sont dus au "mou" (les viscères),
schématiquement à une perturbation de la mobilité
de ces organes. Par de délicates manipulations, l'ostéo
rend leur équilibre et leur mobilité naturelle à
tous les éléments qui composent le corps. Médecine
douce s'il en est. La veille des épreuves importantes, notre ostéo,
le docteur Olivier Bouillon, débarque à notre hôtel
en fin d'après-midi, et ne peut s'échapper que vers 11 heures
ou minuit. Durant le Tour de France, où chaque année il
nous accompagne, les coureurs le consultent en moyenne une fois tous les
deux jours, et des coursiers d'autres équipes prennent aussi rendez-vous.
Devenu un fervent du sport cycliste, Olivier Bouillon sort parfois s'entraîner
avec nous.
Les autres membres du staff médical, diététicien
et kinésithérapeute, sont moins présents. Le diététicien
se contente de venir de temps en temps afin de donner quelques conseils
aux coureurs, d'élaborer des menus types ; le kiné n'est
mobilisé que lors des grandes courses à étapes.
Les soigneurs ne sont ni des kinésithérapeutes ni des
infirmiers. Il n'y a pas de diplôme pour ce métier. Passionnés
de vélo, souvent anciens coureurs, c'est sur le tas qu'ils se sont
formés aux techniques du massage des cyclistes. Un tel massage
porte sur les jambes (pieds, molets et cuisses), parfois aussi un peu
sur le dos. Il dure de trente minutes à une heure. Les muscles
sont tirés, malaxés, écartelés afin d'en éliminer
les toxines, de les assouplir : rude exercice de part et d'autre. Le monstre
qui s'acharne sur la chair dégouline de sueur, et il arrive au
patient de gémir de douleur. Au premier touché, le soigneur
sent la condition de vos muscles, connaît le niveau de votre forme.
Pendant une course, un soigneur s'occupe de trois ou quatre coureurs,
ce qui nécessite une certaine condition physique. Chaque bonhomme
possède sa manière, plus ou moins délicate, plus
ou moins énergique. Les coureurs ont leurs préférences.
Certains n'aiment pas être trop secoués ; d'autres, comme
moi, considèrent que les manipulations vigoureuses leur réussissent
bien. En début de saison, chaque coureur essaye de se faire affecter
le soigneur dont le style lui correspond le mieux. J'ai la chance de bénéficier
depuis cinq ans du même acolyte, Joël Milon, pas du genre à
ménager sa peine. La table de massage incite à la conversation
; le manipulateur devient un confident ; il en sait beaucoup sur
nos états d'âme au jour le jour.
En dehors des massages, les soigneurs sont un peu les hommes à
tout faire. Le soir, ils préparent les bidons et les musettes pour
le lendemain. Cette opération réclame du soin et du temps
: il faut confectionner des sandwichs, couper des tartelettes, ajouter
des barres énergétiques, emballer chaque article séparément
dans un papier aluminium, connaître les goûts et les habitudes
de chacun. Durant le petit déjeuner, pas question qu'un coursier
gaspille la moindre particule d'énergie à réclamer
le thé ou les œufs brouillés qui tardent à venir.
C'est un soigneur qui surveille le service, et, quand il le faut, élève
la voix dans un langage vertement imagé. Pendant la course, certains
soigneurs vont se poster aux points de ravitaillement afin de tendre les
musettes aux coureurs, tandis que d'autres sont dans les voitures, comme
chauffeurs ou passeurs de bidons. À l'arrivée, certains
attendent les coureurs pour les débarbouiller et leur donner des
vêtements chauds, tandis que d'autres se précipitent à
l'hôtel afin de vérifier les réservations, monter
nos bagages que nous ne saurions porter, disposer des bouteilles d'eau
dans les chambres. Ainsi, les journées de travail durent facilement
de douze à quatorze heures. Il faut être loin de chez soi
pendant près de deux cent cinquante jours par an. Et la paye n'a
rien de terrible. Je crois savoir qu'une circulaire officielle interdit
d'employer le mot “soigneur” ; c'est l'appellation “assistant
médical” qui est politiquement correcte. Si ce ridicule changement
de vocabulaire pouvait résoudre les problèmes du cyclisme,
je voudrais bien m'y plier. |
|
[ suite dans le livre : 18 pages… ] |
|
| Chapitre cinq |
| C'est Kiki, il nous envoie te dire... |
— Regarde-moi ! Qui c'est qui t'attend ? C'est La Gaye.
Sur une route du Tour d'Irlande, ma roue avant avait plongé
dans un énorme nid-de-poule que je n'avais pas su éviter.
Après avoir repris mes esprits, attendu ma voiture, changé
de vélo, je m'efforçais de rattraper le peloton, qui n'était
plus qu'un petit point à l'horizon. La lande qui m'entourait offrait
ses profondes couleurs de début d'automne. Au bout de quelques
centaines de mètres, je fus étonné d'apercevoir au
loin un cycliste isolé, portant le maillot de mon équipe,
et qui roulait lentement. Une fois parvenu à sa hauteur, j'ai découvert
une expression gentiment amusée sur le visage de mon coéquipier
Martial Gayant.
— Grouille-toi de m'emboîter le pas. On y va !
Martial Gayant, dit “La Gaye”, aujourd'hui directeur sportif
de la formation Saint-Quentin, me ramena au chaud dans le peloton. Presque
dix ans plus tard, je continue à être ému par son
geste. Un coureur chevronné, ancien Maillot jaune du Tour de France,
qui attend un néo-pro ayant chuté bêtement, comme
un petit bleu qu'il était, cela ne se voit pas tous les jours.
C'était ma première compétition en tant que professionnel.
J'étais intimidé comme un enfant le matin où il accède
à l'école des grands. Et un grand se montrait fraternel.
Quelques jours plus tard, le contre-la-montre individuel de ce beau
Tour d'Irlande me laissa un curieux souvenir. Depuis mon vélo,
la plupart des concurrents que je pouvais apercevoir étaient en
train de tricher. Il y avait ceux qui relayaient avec un collègue,
ceux qui profitaient de l'aspiration d'un véhicule, ceux qui carrément
étaient accrochés au rétroviseur ou à la galerie
de leur voiture. Je n'en revenais pas. Le soir, je demandai poliment à
mes coéquipiers si c'était toujours comme ça chez
les professionnels. Ils m'expliquèrent : "Le Tour d'Irlande,
c'est spécial. D'abord, ils manquent de commissaires, ce qui facilite
le truandage. Ensuite, tout le monde est crevé en fin de saison
; chacun se permet des trucs qui, à une autre période de
l'année, ne seraient pas tolérés par les autres coursiers."
Je dois dire que je n'ai jamais revu un tel spectacle ailleurs.
En 1990, l'équipe Toshiba n'était plus tout à
fait ce qu'elle avait été. Bernard Hinault et Greg Lemond,
qui avaient gagné la Grande Boucle sous ses couleurs, étaient
partis : le premier avait raccroché sa bicyclette et le second
avait signé pour une formation américaine. Mais Toshiba
restait une grosse taule, avec des coureurs comme Jean-François
Bernard, les frères Madiot, Martial Gayant, Denis Roux. Nous avions
tous à peu près le même âge, entre vingt-cinq
et trente ans. Je fus aussitôt bien accepté, et la plupart
des collègues sont vite devenus des copains. Jean-François
Bernard, notre leader, est dans mon panthéon personnel la plus
haute référence du vélo des années 80, juste
après Bernard Hinault. Sa victoire en 1987 dans un contre-la-montre
du Tour de France sur les pentes mythiques du mont Ventoux reste l'un
des exploits cyclistes qui m'ont le plus marqué. Devant la télévision,
j'étais émerveillé par son élégance
sur la machine, sa générosité conjuguée avec
une savante gestion de l'effort, bref sa classe fabuleuse. Mais Jeff,
comme tout le monde l'appelait, était un artiste fantasque. Une
course l'intéressait, il la gagnait ; une autre course l'ennuyait,
il finissait avec la voiture-balai. Par exemple, lors du Tour d'Espagne
en 1990, je l'ai vu terminer les premières étapes à
la limite des délais. "Aujourd'hui, j'ai frisé la correctionnelle",
nous disait-il chaque soir, en faisant bien savoir qu'il n'avait aucune
envie de disputer le Tour d'Espagne, que cette corvée lui avait
été imposée par le directeur sportif. Puis, le jour
du contre-la-montre individuel, sur un parcours très exigeant,
il décida de montrer ce qu'il savait faire ; et il l'emporta avec
plus de 2 minutes d'avance sur le deuxième, qui n'était
autre que Stephen Roche. Le lendemain, il se traînait de nouveau
dans le gruppetto. Il était un aristocrate du contre-la-montre,
l'épreuve de vérité. Et aussi un garçon très
sympathique.
Au bout de quelques mois, ma réputation dans le milieu fut bâtie
autour de trois composantes. Premièrement, excusez-moi de me vanter
un peu, j'étais reconnu comme le genre d'équipier modèle
qui se met à la planche sans retenue, prêt à mourir
pour son leader, une espèce en voie de disparition. Deuxièmement,
comme beaucoup de débutants, j'étais considéré
comme un chien fou : un trou, je le bouchais ; une attaque, j'y allais
; je flinguais* à tout va ; et cela jusqu'à l'épuisement...
Il m'arrivait aussi de me lancer dans de folles aventures. Par exemple,
lors de la classique ardennaise Liège-Bastogne-Liège en
1992, je me suis enfui en solitaire dès le premier kilomètre,
sous les flocons d'une averse de neige, avec la ferme intention d'aller
au bout. Les quelque deux cents participants ont dû chasser durant
120 kilomètres avant de me reprendre. Aujourd'hui, quand un jeune
nous sert ce plat-là, je dis qu'il est “pète-couilles”,
et j'ai raison. Troisièmement, mon efficacité en descente
en impressionnait plus d'un. Jean-François Bernard, notamment,
venait souvent me voir après les courses.
— Fais gaffe ! Tu vas finir par te viander.
— Ah ! j'anticipe, c'est tout un art.
Lors d'une étape du Tour de Valence en 1990, dans une belle
descente, j'étais en tête de la course, et à la limite,
comme d'habitude. Je suis entré trop vite dans un virage vicieux,
et j'ai immédiatement réalisé que j'allais sortir
côté ravin. J'ai eu le temps de jeter un coup d'œil vers
le comité d'accueil : des arbres, des rochers, rien de bien agréable...
Comme souvent sur les routes de montagne, un petit muret de pierre bordait
le virage. Dans un réflexe qui m'étonne encore, je réussis
à sauter de mon vélo et à improviser un atterrissage
à plat ventre sur le parapet, que j'ai agrippé des quatre
fers. Un peu étourdi, je suis resté quelques instants dans
cette position. Les hurlements de rire du peloton qui me dépassait
me tirèrent de ma torpeur. Pendant des semaines, j'ai été
chambré sur le thème "Bravo Bourgui, bien anticipé
!"
Durant le Tour d'Espagne 1990, toujours dans une belle descente, j'ouvrais
la voie pour Jeff et quelques coéquipiers qui suivaient mes trajectoires.
Du bord de la route, un motard de l'organisation agita un drapeau rouge,
signe d'un danger prochain. Je me suis relevé, redoublant d'attention.
Une trentaine de mètres plus tard, rien d'extraordinaire n'était
apparu. "Le motard a dû se tromper d'endroit", me suis-je
dit, et j'ai lâché les freins, tandis que mes camarades,
plus méfiants, restaient sur leur garde. À la sortie du
virage suivant, la route avait... disparu. Devant mes yeux écarquillés,
une piste de terre et de gravas, avec ornières et nids-de-poule.
J'ai dû m'engager dans ce champ de mines à plus de 50 km/h.
La moindre pression sur les freins, et c'était la gamelle. Je ne
sais pas comment j'ai pu m'en sortir, mais, après 50 mètres
d'une succession de cascades, je retrouvai la route goudronnée.
Ce jour-là, j'ai creusé l'écart sur le reste des
coureurs. Et j'ai rarement eu aussi peur. |
|
[ suite dans le livre : 18 pages… ] |
|
| Chapitre six |
| Préparation médicale |
Ce sujet, j'aurais préféré l'éviter. Le
dopage, que puis-je raconter d'intéressant ? Tout a déjà
été dit, écrit, répété. Je n'ai
pas envie de tartiner des cours de morale. Je n'ai pas envie de contribuer
à salir le milieu du cyclisme dans lequel j'évolue, et que
je respecte, en dépit de ses défauts. Je n'ai pas envie
de balancer des accusations plus ou moins sommaires et sournoises. En
quoi mes idées peuvent-elles aider à trouver des solutions
? Je ne suis ni un médecin ni un homme politique. Sous de nombreux
aspects, je ne connais pas bien la question. Mon discours va être
émaillé d'inexactitudes, et cela me sera reproché.
Si j'avais une solution toute faite, il y a longtemps que cela se saurait.
Si c'était tellement facile, il y a longtemps que le problème
serait résolu. Pourtant, si j'esquivais l'obstacle, vous penseriez
que j'ai des choses à cacher, ou que je vous propose une vision
édulcorée de notre sport. Alors allons-y !
J'appartiens à la génération
qui a vu exploser le dopage. À mes débuts, autour
de 1990, il existait déjà de nombreux produits, en
particulier les corticoïdes et les anabolisants, sans oublier
les bonnes vieilles amphétamines. Cependant, au sein du peloton,
il était entendu que ces saletés ne pouvaient pas
transformer un âne en cheval de course. Ça aidait,
c'était probable, mais enfin, ça n'allait pas changer
une carrière, et il était possible de gagner sans
y avoir recours : de grands champions étaient renommés
pour tourner à l'eau claire. L'apparition de l'EPO et de
l'hormone de croissance, vers 1993-1994, a fait basculer la situation.
Des coureurs jusqu'alors anonymes ont soudainement réalisé
d'énormes progrès ; des bourricots se sont métamorphosés
en pur-sang. Simultanément, le phénomène a
été médicalisé. Le candidat aux artifices
ne s'adressait plus à un obscur rebouteux inmontrable, traficoteur
d'ordonnances plusieurs fois condamné en justice, ex-culturiste
tenant ses “consultations” dans des bars infâmes,
mais à un digne médecin, parfois très réputé,
grassouillet, avec un beau cabinet, une secrétaire pomponnée
et un langage savant. Certains parlaient de “préparation
médicale”. Seuls le montant des honoraires, le coût
des “médicaments” et les détours à
emprunter pour se les procurer laissaient encore supposer qu'il
ne s'agissait pas d'un acte thérapeutique entièrement
banal. J'exagère à peine. Et puis la “médecine”
est entrée au cœur de quelques équipes, surtout
italiennes au début. Plus besoin d'aller chercher à
l'extérieur, c'était le toubib de la formation qui
prescrivait directement les traitements miracles. Imaginez la tentation
pour un jeune coureur, qui a déjà consenti tant de
sacrifices pour être là où il est. Untel et
Untel, qu'il avait l'habitude de pulvériser quelques mois
plus tôt, commencent à réussir beaucoup mieux
que lui. Depuis un an ou deux, il n'a plus gagné une course.
Son contrat arrive à expiration, il aura des difficultés
à retrouver un emploi, et de toutes façons son salaire
va être divisé par trois, car sa cote s'est effondrée.
Et voilà un médecin, peut-être celui de son
équipe, qui explique que "bon, d'accord, c'est une petite
tricherie, ça coûte un peu cher, mais c'est pas fait
n'importe comment, c'est suivi dans les règles, et ça
donne des résultats". Avant de lui jeter la pierre,
essayez de vous mettre à sa place. Moi-même, avant
que l'on sache tout ce que l'on sait, j'ai failli signer chez Festina.
Si j'avais été dans cette formation où le dopage
était si bien organisé, qu'aurais-je fait ? Honnêtement,
je l'ignore. Et, rétrospectivement, je considère l'échec
de ce transfert comme une chance de ma carrière.
Pour compléter le tableau, il faut souligner que les coureurs
“scientifiques” bénéficiaient (et bénéficient
toujours !) d'une quasi-impunité. Les contrôles antidopage,
je ne vous apprends rien en déclarant qu'ils sont ridiculement
inefficaces. Ils ne détectent ni l'EPO, ni l'hormone de croissance,
ni la plupart des dopants puissants. En revanche, le jour où je
suis grippé, je dois respecter une infinité de précautions
afin d'éviter des sirops contre la toux et autres suppositoires
contre la fièvre contenant des principes actifs qui feraient exploser
les éprouvettes.
Quand par hasard un coureur particulièrement négligent
est attrapé, car il s'est trompé dans la posologie, ou il
a oublié d'avaler les produits masquants, le premier avocat un
peu malin parvient à débusquer des vices de forme qui empêchent
les poursuites. Je vous épargne les détails, mais un contrôle
antidopage est astreint à des règles très strictes
: la pièce où il est pratiqué doit mesurer une certaine
taille, il ne faut pas qu'il y ait plus de tant de personnes à
l'intérieur, les machines doivent être comme ci et comme
ça, etc. De plus, les procédures sont incroyablement complexes,
avec différentes juridictions, des circuits d'appel, des délais...
Ainsi, la plupart des contrôles positifs sont discrètement
enterrés. Quelques avocats spécialistes de ces labyrinthes
ont bâti leur fonds de commerce sur l'art de protéger les
tricheurs.
En admettant que la procédure aille à son
terme, ce qui se produit quand même de temps en temps, les
sanctions sont une rigolade : de trois à six mois de suspension
pour un contrôle d'urine positif. Le condamné se débrouille
pour purger sa peine pendant l'hiver, et il revient en pleine forme
au printemps. Quant à un contrôle de sang positif (taux
d'hématocrite supérieur à 50 %), il se solde
par un "arrêt de travail" de quinze jours, rien
de plus.
Donc, les “préparations médicales” se sont
répandues. C'était un sujet de conversation dans le peloton.
Des néo-pros m'en apprenaient tous les jours : il paraît
que tel machin donne de la force, que tel truc aide à respirer,
etc. D'un côté, par le bouche à oreille, on était
assez bien au courant de ce qui se tramait. D'un autre côté,
à cause de l'absence de fiabilité de ces maudits contrôles
antidopage, il n'y avait aucune certitude. Tout le monde suspectait tout
le monde, et personne n'avait de preuve. À part quelques barjos,
celui qui se dope, il ne va pas le crier sur les toits. Peut-être
que mon compagnon de chambre avale des trucs, aux toilettes, derrière
mon dos... Les seules personnes dont je puisse être sûr sont
moi-même et, à la rigueur, mes meilleurs amis. Au printemps,
des collègues réapparaissaient avec des cuisses deux fois
plus grosses que trois mois auparavant : "j'ai fait de la musculation
pendant l'hiver", expliquaient-ils en baissant les yeux. Ah oui ?
Moi aussi j'ai fait de la musculation, et même beaucoup de musculation,
mais la forme de mes jambes n'a pas bougé d'un millimètre.
Néanmoins, pas question d'accuser le confrère, même
si l'on nourrit une grosse suspicion. Par exemple, j'ai un ami, il suffit
qu'il soulève un peu de fonte pendant une semaine pour que ses
cuisses changent de volume ; et je ne le suspecte pas de prendre des produits,
d'autant moins qu'il a arrêté sa carrière. C'est une
affaire de métabolisme. Selon moi, aucun sportif ne peut être
accusé de dopage à la vue de sa morphologie, aussi étonnante
soit-elle. En revanche, quand un coureur déjà un peu ancien,
dont le niveau est étalonné, éclate du jour au lendemain,
surtout dans l'exercice du contre-la-montre, alors là mes doutes
se muent en quasi-certitude. Un jeune, on peut comprendre qu'il ait besoin
de deux ou trois ans pour apprendre son métier ; mais un vieux
renard qui tout d'un coup gagne quarante ou cinquante places au classement
UCI, j'ai du mal à y croire. Si un jour vous me voyez figurer dans
les dix premiers d'un prologue du Tour de France, soyez sûrs que
je serais chargé comme un mulet. Encore que... vous n'aurez pas
de preuve... Cette situation "je sais tout-je sais rien" nous
a plongés dans un océan d'hypocrisie, pas seulement les
coureurs, mais le monde du cyclisme en général. Avec des
journalistes qui aujourd'hui nous servent des leçons sur tous les
tons, je me souviens avoir eu vers 1996-1997 des conversations du genre
:
— Thierry, si tu déclares que chez Untel ils sont tous
plombés, nous te laissons une pleine page pour t'exprimer.
— Pourquoi vous ne le dites pas tout seul ?
— Si c'est toi qui le dit, ça aura plus de poids.
— Dites-le d'abord, et moi je confirme ensuite.
— Nous, on ne peut pas le dire, on n'a pas de preuve, on va se
prendre un procès.
— Vous êtes gentils, mais moi non plus je n'ai pas de preuve,
pas plus que vous...
Il fallut attendre juillet 1998, la fameuse affaire Festina, l'intervention
de la police et de la justice, pour que le grand déballage commence.
Ce n'était pas trop tôt, car une bonne partie du peloton
en était arrivée à faire n'importe quoi. |
|
[ suite dans le livre : 16 pages… ] |
|
| Chapitre sept |
| Chez Madame Jeanne |
Les saisons 94-95 et 95-96 auraient dû être les plus
belles de ma carrière. Chez Toshiba, puis chez Castorama, j'avais
accompli mon apprentissage. Après cinq années de professionnalisme,
j'étais à la fois expérimenté et affûté,
aguerri sans être fatigué, au meilleur âge pour quelqu'un
qui comme moi a débuté tard, bref au sommet de mes moyens.
Les directeurs sportifs commençaient à m'accorder leur confiance,
les équipiers étaient disposés à travailler
pour moi. Pourtant, si je feuillette mon palmarès, cette période
n'a rien de faste. Pas à cause des chutes ou des accidents, bien
qu'il y eut des chutes et des accidents. Simplement, les deux équipes
qui furent les miennes à cette époque, Le Groupement puis
Force Sud, firent faillite, proprement, consciencieusement, l'une après
l'autre, comme si elles s'étaient donné le mot, me laissant
à chaque fois sur le pavé plus ou moins tôt dans la
saison. Ce chapitre est banal. C'est juste l'histoire d'un type qui a
des ennuis avec ses employeurs.
En mai 1994, après deux semaines de course, j'étais quinzième,
et premier Français, du classement général du Tour
d'Italie. Plusieurs étapes dans le massif des Dolomites étaient
au menu de la dernière semaine. La pente ne m'ayant jamais fait
peur, j'espérais bien grappiller encore quelques places, et signer
là un résultat respectable. Cependant, à la fin de
l'étape qui nous amenait au pied de la montagne, je ressentis une
violente douleur à la cuisse droite. Un bon gros diesel comme moi,
cela tombe rarement en panne. Mais, cette fois, c'était un coup
de poignard à chaque tour de pédale. Quand je me mettais
en danseuse, ça allait un peu mieux, mais bon, terminer le Tour
d'Italie sans poser les fesses sur la selle, cela semblait compliqué...
Je dus bâcher. Le diagnostic fut immédiat : micro-claquage.
Rien de bien grave. Une dizaine de jours de repos devait suffire à
un rétablissement complet. J'étais rentré chez moi,
et je fus assez étonné quand, seulement trois ou quatre
jours après mon abandon, Cyrille Guimard m'appela au téléphone,
et, après avoir demandé de mes nouvelles, voulut que je
me livre à une séance d'entraînement particulièrement
intensive :
— Mais enfin, tu sais ce que j'ai à la cuisse. Si le micro-claquage
n'est pas guéri, je risque une grosse déchirure musculaire.
— Justement, je veux savoir si tu peux venir au stage de l'équipe
à Font-Romeu, qui commence dans deux jours : ça passe ou
ça casse !
En brave soldat, je me suis exécuté sans tricher. Ça
a passé. Je me suis rendu au rassemblement de l'équipe,
qui durait une semaine, juste avant le Championnat de France.
Dans notre pays, il existe une curieuse tradition qui veut que les
directeurs sportifs ne révèlent qu'au tout dernier moment
la liste des coureurs qu'ils ont choisis pour disputer la Grande Boucle.
Les deux ou trois têtes d'affiche de l'équipe ne doutent
pas de leur sélection ; les néo-pros, les blessés
et ceux qui ont raté leur saison sont sûrs d'être éliminés
; et tous les autres coureurs sont plongés dans l'incertitude.
En réalité, il s'agit de nous laisser sous pression le plus
longtemps possible. Au fond de lui-même, tout directeur sportif
est persuadé que, dès qu'il aura annoncé la composition
de son équipe, son effectif s'arrêtera de bosser : les élus
car ils se moqueront des autres compétitions, les exclus car ils
seront démotivés. Nous considérer de cette manière,
disons comme des gamins, ce n'est pas méchant, mais il y a un effet
pervers. Durant les huit à dix semaines qui précèdent
le Tour, les coureurs n'ont qu'un seul objectif : se faire remarquer.
Ils se surmènent. Quant au stage ”d'avant Tour”, il
apparaît comme un ultime examen. C'est à qui fera péter
les autres. Ainsi, au prologue de la Grande Boucle, nous nous présentons
physiquement et nerveusement fatigués. C'est idiot mais c'est comme
ça.
À ma connaissance, dans les équipes étrangères,
les sélections sont dévoilées de huit à dix
semaines avant le départ. Chez Toshiba, Bernard Vallet agissait
de même. Et, comme par hasard, ce fut au sein de sa formation que
mes performances sur le Tour furent les plus spectaculaires, alors que
j'étais encore néo-pro.
Le stage à Font-Romeu fut pénible, avec des montées
de col à toute allure, du gros travail en altitude. Je mis les
bouchées doubles, et j'avais le sentiment d'avoir montré
une excellente condition physique. Le micro-claquage était complètement
oublié. Lors d'une réunion générale quelques
jours plus tard, juste après le championnat de France, Cyrille
Guimard annonça sa sélection. Je n'étais pas retenu.
Je n'ai pas réclamé d'explications ; ce n'est pas dans nos
usages, les verdicts du patron sont sans appel. Peut-être voulait-il
cette année-là bâtir une équipe de sprinters.
Cependant, si sa décision de m'écarter était déjà
prise avant le stage, pourquoi m'avoir demandé d'écourter
ma convalescence, au risque d'une sérieuse blessure ? Cyrille assurait
vouloir me conserver dans son équipe, prolonger mon contrat, mais
j'avais l'impression que, après trois ans de collaboration, notre
relation était usée. J'écris cela sans animosité.
Nous continuons à nous saluer avec le sourire, et, quand nous avons
l'occasion de bavarder, c'est toujours avec plaisir et intérêt,
du moins en ce qui me concerne.
Pour la première fois depuis trois ans, je regardais le Tour
de France à la télévision. Un soir, je reçus
un coup de téléphone de Guy Mollet, que j'avais vaguement
croisé à diverses occasions car il avait dirigé des
équipes d'amateurs dans le Nord. Après quelques politesses,
il me raconta qu'il préparait une bonne équipe, avec un
sponsor important, et qu'il souhaitait me recruter :
— Qui c'est ce sponsor ?
— C'est une entreprise nouvelle. Ils distribuent plein de produits,
un peu comme La Redoute. Enfin, c'est de la vente à domicile, un
peu comme Tupperware, tu connais Tupperware ?
— Hum !
— Ils sont prêts à dégager le budget qu'il
faut pour que l'on monte une grosse taule, avec des calibres dont je ne
peux pas te dire encore les noms, mais c'est pas n'importe qui. Pour le
salaire, ne t'inquiète pas, tu seras payé au moins 30 %
de plus par rapport à Castorama, j'en fais mon affaire. Si tu veux,
je t'arrange le plus tôt possible un rendez-vous avec les dirigeants
du Groupement, et...
— Hum ?
— Oui, ça s'appelle comme ça, Le Groupement, et
tu verras par toi-même.
Peu après, je me rendis au siège du Groupement. Le patron,
Jean Godzich, m'emmena visiter des bureaux agréables, occupés
par des personnes bien habillées et souriantes. Puis il m'accompagna
vers un immense entrepôt bourré des marchandises les plus
diverses. La préparation des colis était entièrement
automatique. Des boîtes en carton de différentes tailles
partaient vides sur un tapis roulant qui parcourait tous les rayonnages.
Sur chaque boîte, un code-barres généré par
ordinateur indiquait la liste exact des produits à revevoir. Devant
chaque rayon, un lecteur de code-barres analysait le contenu de la commande,
et, si nécessaire, un bras électrique déposait délicatement
les produits demandés. Tandis que nous déambulions au sein
de cet étrange manège, Jean Godzich m'expliqua qu'il commercialisait
tout ce qui est utile dans la maison, produits d'entretien, cosmétiques,
vaisselle, vêtements, etc., et que son succès était
phénoménal après seulement quelques années
d'existence.
Le Groupement était basé sur ce qui s'appelle un système
de ventes pyramidales. Les vendeurs sont rémunérés
non seulement par un pourcentage (disons 25 %) sur leurs ventes directes,
mais également par un autre pourcentage (disons 10 %) sur les ventes
réalisées par les vendeurs qu'ils ont recrutés, qui
appartiennent à leur “groupe”. Concrètement,
les vendeurs sont des particuliers comme vous et moi : ils fourguent la
marchandise auprès de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues.
Et ils s'efforcent de constituer un groupe en transformant en vendeurs
ces mêmes parents, amis, collègues... qui eux aussi constitueront
des groupes... Ainsi, les affaires se développent très vite.
Jean Godzich m'exposa aussi qu'il investissait dans le cyclisme à
long terme, pour au moins cinq ans, avec la ferme ambition de bâtir
la meilleure équipe française. Cependant, il ne cherchait
pas à m'en mettre plein la vue. Il m'apparaissait à la fois
battant et humble, le genre de personnes pour lesquelles j'éprouve
une sympathie immédiate. Quelques jours après cette rencontre,
je signai mon contrat, très satisfait de m'engager dans un nouveau
défi sportif. |
|
[ suite dans le livre : 24 pages… ] |
|
| Chapitre huit |
| Capitaine de route |
Le premier Tour de France avec Auber 93 Peugeot, nous l'avons terminé
à trois. Durant les deux premières semaines de l'épreuve,
six des neuf équipiers avaient dû bâcher, qui sur blessure,
qui sur chute, qui hors délai. Chez Force Sud, il y avait des coureurs,
mais pas d'encadrement. Chez Auber 93 Peugeot, je me retrouvais soudain
dans une situation inverse : deux directeurs sportifs, deux mécanos,
deux soigneurs, une secrétaire et une attachée de presse
pour seulement trois coursiers ; Thierry Gouvenou, Gilles Talmant et moi.
Lors des dîners, c'était amusant : au centre du restaurant,
le vaste couvert de l'encadrement, des sponsors, des invités, joyeuse
assemblée d'une vingtaine de personnes ; dans un coin, la table
des coureurs, minuscule et intime. C'est à peine si les serveurs
nous remarquaient. Le soir du contre-la-montre individuel de Bordeaux,
les feuilles de classement apportées par un motard de l'organisation
furent accaparées par la grande tablée. Nous les entendions
commenter bruyamment les résultats. Au bout d'un moment, Thierry
Gouvenou s'est levé et, dans la bonne humeur, a déclaré
: "Quand même, vous pourriez nous passer au moins une feuille,
nous aussi nous sommes concernés..."
Ne pas perdre encore un homme était notre ambition principale,
ne serait-ce que pour continuer à figurer dans le classement par
équipe qui est établi sur la base des résultats des
trois meilleurs coureurs de chaque formation. Les jours de galère,
nous nous encouragions ; nous nous aidions mutuellement, au-delà
des usages. Mieux, nous sommes parvenus à exister dans la course,
à nous glisser dans quelques bons coups. Personnellement, j'ai
terminé deux étapes au sein de l'échappée
victorieuse, battu au sprint, comme d'habitude, mais classé les
deux fois sixième. Encore mieux, durant la deuxième semaine,
l'un de nos coéquipiers, Cyril Saugrain, avait emporté une
étape exigeante, celle qui s'achevait au lac de Madine. L'accession
de notre équipe au niveau de l'élite n'était pas
passée inaperçue. Et puis, en France, on aime bien les petits
Poucet. Les médias ont beaucoup parlé de nous. Le soir de
l'arrivée à Paris, Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour
de France, est venu nous serrer la main : "Bravo, les gars, vous
avez honoré votre invitation."
Avec Thierry et Gilles, nous avons vécu une belle aventure.
La veille de l'arrivée à Paris, nous avions convenu de ne
renouveler notre contrat chez Auber 93 Peugeot que si nous étions
tous trois réengagés. La remontée des Champs-Élysées,
ce fut une émotion particulière. Et nous avons effectivement
resigné ensemble.
Créé en 1948, le Club municipal d'Aubervilliers (C.M.
Aubervilliers) était à ses débuts un modeste club
de quartier. Vers 1985, avec le soutien de la mairie et du conseil général,
le président, Jean Sivy, s'appliqua d'une part à étendre
son action à l'ensemble du département de la Seine-Saint-Denis,
et d'autre part à promouvoir le cyclisme sous tous ses aspects
: sport de compétition, mais aussi sport-loisir, sport éducatif,
sport pour l'intégration sociale. En 1994, l'équipe rassemblant
les meilleurs amateurs acquit un statut professionnel. Après notre
prestation lors du Tour de France 1996, les magasins de bricolage BigMat
débarquèrent comme sponsor principal et consolidèrent
l'édifice. Le club dénombre aujourd'hui plus de cent soixante-dix
licenciés engagés en compétition. Au niveau amateur
(cadets, juniors, coureurs nationaux et Élite 2), notre structure
est actuellement la plus importante et performante en France. Au sommet
de la pyramide, l'équipe professionnelle compte dix-sept coureurs
sous contrat.
Depuis plusieurs années, le cyclisme professionnel est régi
selon le système des points UCI. Chaque course, en fonction de
son importance, distribue un certain nombre de points UCI. Par exemple,
pour Paris-Nice, le vainqueur récolte 220 points, le deuxième
165, le troisième 132, etc. Les formations sont classées
selon le cumul des points des coureurs qui les composent. Au niveau mondial,
les vingt-deux équipes capitalisant le plus de points sont admises
en première division ; les trente-sept suivantes sont en deuxième
division. Les équipes de première division sont presque
automatiquement invitées à toutes les épreuves auxquelles
elles souhaitent participer. Les places restantes sont attribuées
aux équipes de deuxième division, qui sont sélectionnées
en fonction de leurs résultats récents.
Ce système en vaut peut-être un autre, mais il comporte
des mauvais côtés. Le premier inconvénient, c'est
que l'aspect collectif de notre sport n'est pas valorisé. Quand
un leader remporte une classique, il le doit bien sûr à sa
classe, mais aussi au travail des équipiers qui se sont sacrifiés
pour le protéger. Or ces derniers ne marquent aucun point. Ensuite,
c'est la part belle à l'argent-roi. Si une équipe rate sa
saison, il lui suffit d'embaucher des coureurs ayant des points UCI pour
se maintenir au sein de l'élite. C'est un peu comme si un club
de football terminant dernier du championnat pouvait rester en première
division en achetant les meilleurs joueurs des autres équipes.
En ce qui concerne les salaires, chaque coureur vaut le nombre de points
UCI qu'il a accumulés : tant de points UCI, tant de milliers de
francs par mois. Les coureurs comme moi, qui pèsent peu de points
UCI, sont objectivement sous-cotés. Mais bon, je sais que j'ai
une valeur, et je m'efforce de la faire reconnaître au mieux.
Dans la presse, je lis que le budget de la Mapei est de 70 millions
de francs ; celui de la Once, 40 millions de francs ; celui de BigMat
Auber 93, 16 millions de francs. Sur le plan du matériel, de l'encadrement
et des méthodes d'entraînement, nous n'avons rien à
envier aux meilleures formations ; mais, n'ayant pas les moyens de payer
beaucoup de points UCI, nous sommes cantonnés en deuxième
division. Gagner notre invitation pour le Tour de France est l'objectif
primordial de notre saison. Chaque année, nous devons batailler
pour y parvenir.
Notre équipe se compose à la fois de baroudeurs expérimentés,
comme Thierry Gouvenou, Dominique Rault, Lylian Lebreton, Christophe Capelle,
Denis Leproux, de jeunes souvent issus du centre de formation d'Aubervilliers,
comme Alexandre Chouffe, Sébastien Tabalardon, Guillaume et Ludovic
Auger, Loïc Lalouller, Stéphane Bergès, Carlos Da Cruz,
et de quatre étrangers, les Russes Alexeï Sivakov et Oleg
Joukov, l'Australien Jay Sweet et l'Anglais Jeremy Hunt (je n'ai oublié
personne). L'ossature est excellente, mais il nous manque toujours un
grand leader. Il faudrait qu'un ou deux de nos jeunes éclatent
au plus haut niveau, et que nous puissions les garder pendant quelques
saisons. Pourquoi pas.
Stéphane Javalet, notre directeur sportif, est, j'écris
cela sans flagornerie, un grand psychologue. Quand un coureur ne marche
pas, il prend le temps de discuter. Si un coursier est blessé,
il lui laisse le temps de se reconstruire, de revenir sans brûler
les étapes. Il attend. Il comprend. La santé du coureur
avant tout. Stéphane est aussi un homme de terrain qui sait se
faire respecter.
Les dirigeants de BigMat, Jean Adou et Jean-Luc Leroy, sont des
passionnés de sport. Mais, contrairement à certains
sponsors, ils ne se mêlent pas des questions techniques :
le calendrier, la composition des équipes et le choix des
recrues sont entièrement délégués à
Stéphane Javalet. De même, tout en demandant des comptes
et des résultats, ils ne cherchent pas à nous imposer
des objectifs délirants, ni à nous enquiquiner avec
des obligations extra sportives. Ils sont à la fois de vrais
professionnels et de chaleureux supporters.
Il faut croire que je me sens bien dans cette équipe. En l'an
2000, j'entame ma cinquième saison sous ses couleurs. Encore récemment,
j'ai décliné les propositions pourtant financièrement
très intéressantes d'une autre formation.
Le jeune chien fou que je fus s'est transformé en ce qu'on appelle
un capitaine de route. Mon travail, en liaison avec Thierry Gouvenou,
qui partage cette responsabilité avec moi, est d'organiser la manœuvre
pendant la course. Lors du briefing du matin, le directeur sportif fixe
un cadre stratégique général ; mais, sur le terrain,
il faut faire face aux imprévus ; l'évolution de la météo
et surtout du vent, la forme des uns et des autres, l'humeur du peloton,
les événements de la course. Dès le départ,
je me positionne dans le premier quart du peloton ; tel un vieux renard,
j'observe, je flaire, je soupèse, je me remémore des configurations
identiques ; je cerne la tournure. Si je sens qu'un bon coup peut décoller,
je rameute un ou deux coéquipiers en forme, dont le style convient
au parcours, pour qu'ils se tiennent aux aguets. Si l'un de nos coéquipiers
part au charbon, je demande à d'autres éléments de
l'équipe de monter en tête du peloton afin de parer un contre
éventuel, ou d'essayer de casser la cadence. Inutile d'ajouter
que j'ai rarement le temps de m'ennuyer pendant une compétition. |
|
[ suite dans le livre : 20 pages… ] |
|
| Chapitre neuf |
| Tellement de pancartes |
— Thierry, j'ai une idée d'émission : la course
racontée par les cyclistes, non plus par les journalistes. Le soir,
tu me parles de ce que tu as vu et vécu dans la journée.
Ensuite, je m'occupe de monter les meilleurs passages, d'agrémenter
avec quelques images, et on diffuse une dizaine de minutes le lendemain,
peu avant la retransmission de l'étape en direct. A priori, je
pense employer trois coureurs, un par semaine. Si tu veux, on commence
avec toi.
Pierre Salviac, rédacteur en chef du service des sports de France
2, était venu me rencontrer à mon hôtel, peu avant
le prologue du Tour 1999. Notre équipe BigMat Auber 93, comme toutes
celles qui participent à la Grande Boucle, s'installe avec deux
ou trois jours d'avance dans la ville-départ, qui en l'occurrence
était le Puy-du-Fou : il y a quelques formalités à
remplir (visite médicale obligatoire, remise des dossards, conférence
des organisateurs, etc.), et c'est aussi pour le directeur sportif l'occasion
de réunir les neuf coureurs sélectionnés, commenter
le parcours, entretenir la forme par quelques derniers entraînements
légers, répartir les tâches des mécanos et
soigneurs, bref régler les détails. Cette période
d'attente, ultime répétition avant le spectacle, mobilisation
de l'armée avant les hostilités, est toujours énervante
pour les coureurs. Mais jamais l'atmosphère n'avait été
poisseuse comme en cette année 1999. Affaire Festina, affaire Pantani,
affaire "docteur Mabuse", la presse ne parlait que du dopage.
La plupart des journaux avaient dépêché les limiers
du fait divers en plus des chroniqueurs sportifs. Chaque jour, les mésaventures
du Tour 1998 étaient rappelées : exclusion de l'équipe
Festina, grève des coureurs dénonçant les conditions
des contrôles antidopage, abandon volontaire de plusieurs formations...
De plus, l'histoire des "réintégrés" défrayait
la chronique : les organisateurs avaient déclaré "pas
bienvenus" quelques équipes ou coureurs, mais l'Union cycliste
internationale (UCI) avait imposé la réincorporation de
plusieurs proscrits, dont Richard Virenque et le directeur sportif espagnol
Manolo Saiz. Cet épisode faisant un peu désordre, des sponsors
importants avaient menacé de se retirer. Le Tour 1999 pouvait-il
aller à son terme ? Ne serait-il pas le dernier ? Ces questions
étaient posées.
Le public restait bon enfant, mais une minorité, c'était
compréhensible, se manifestait plus ou moins délicatement.
Parfois, de la foule des badauds qui se forme et se reforme où
que nous allions, nous entendions des railleries jaillir du troisième
ou quatrième rang, quand la masse permettait l'anonymat. Lors de
nos sorties d'entraînement, nous lisions sur la route des inscriptions
peu aimables, toujours autour du même thème. Comme je l'ai
dit quelques jours plus tard dans l'émission : "Je ne sais
pas qui est le coureur EPO, mais il est vachement encouragé..."
Au premier contact, Pierre Salviac dut ressentir une certaine méfiance
de ma part. Je le connaissais sans le connaître, comme je connais
sans les connaître la plupart des journalistes. Chaque année,
il venait sur le Tour de France. Mais sa spécialité est
le rugby, pas le vélo. Il n'interviewait pas les cyclistes, et
nos rapports n'avaient jamais dépassé le stade de la poignée
de main "bonjour-bonsoir" quand nous nous croisions.
— Pourquoi m'avez-vous choisi ?
— Tu as la réputation de ne pas avoir la langue dans ta
poche, et d'être plutôt marrant. En plus, excuse-moi, tu es
un ancien, le Tour n'a pas de secret pour toi. L'idée, je te le
répète, est toute simple : je te donne la moitié
de ma carte de presse, tu es mon reporter dans le peloton. Et puis, dis-moi
"tu", s'il te plaît.
— Ça me prendra combien de temps par jour, votre..., euh...,
ton émission ?
— Pas mon émission, NOTRE émission. Compte environ
trente à quarante minutes de causerie, et le temps de s'installer.
Disons une heure par jour, au maximum.
— Il faudrait que je sois assis, c'est obligatoire pour récupérer.
— Bien sûr ! j'ai même prévu de te placer
sur un fauteuil de metteur en scène, avec ton dossard sur le dossier.
Tu t'assois à l'envers, le dossier face à la caméra.
Je te pose des questions, mais on ne me voit pas dans le champ. Je considère
que ce sont les coureurs qui sont les vedettes, pas les journalistes.
— On parlera de quoi ?
— De tout, de rien, de la course, mais sur un ton très
décontracté, très proche du public, comme si tu discutais
avec un copain.
— Ah oui ? Pourquoi pas ? Je vous..., euh..., je te donne demain
ma réponse, je dois en parler à mon équipe, voir
s'ils sont d'accord.
La suite, j'imagine que les lecteurs de ce livre la connaissent un
peu. L'émission fut un tel succès que, contrairement à
ce qui était prévu à l'origine, je ne fus pas remplacé
en fin de première semaine ; à l'issue de la deuxième
semaine, la question d'une éventuelle substitution ne fut même
pas évoquée. "Si je te vire, c'est moi qui suis viré",
plaisanta Pierre Salviac. L'émission avait lieu tous les jours
vers 14 h 45, sauf après les deux journées de repos et durant
les grandes étapes de montagne qui étaient diffusées
en direct dans leur intégralité. Sur vingt jours de courses,
il y eut treize "Moi, Thierry Bourguignon, dossard 192 du Tour de
France". Cela représente au total plus de deux heures d'antenne,
la distance d'un long film de fiction. Il faut croire que le vélo
est un sujet inépuisable, et qu'il n'est jamais difficile de parler
de ce que l'on aime. La conversation était entièrement improvisée
; cependant, un ami journaliste, après avoir visionné et
revisionné un enregistrement de l'œuvre complète, avec
la dévotion qu'elle mérite, m'assure que tout mon bavardage
peut être découpé et classé en sept thèmes.
Ces thèmes sont les suivants :
1. Bourgui parle de lui, mais sans se prendre au sérieux.
Par exemple, mes premiers mots, lors de la première émission
:
"Le chrono, comme on dit, il faut partir vite, accélérer
au milieu, et finir très fort. J'y arrive jamais, moi... Il y a
toujours un moment où, crcrcric, la machine elle s'enrhume, où
elle se bloque. […] Un prologue de plat, à la rigueur, on
peut gérer le truc, on risque pas d'être trop-trop loin,
mais alors là […] plat, montée, descente, mal aux
jambes, mal aux jambes ! […] La ligne, elle me fuit... D'ailleurs,
à 500 mètres, plus j'approchais, plus elle s'en allait,
j'avais l'impression."
2. Bourgui devise sur quelques coureurs dans le peloton, généralement
pas les plus connus.
Par exemple, lors de la difficile traversée des Pyrénées
:
"J'ai un grand coup de chapeau à donner à Jay Sweet.
[…] Aujourd'hui, il se fait sortir dans le premier [col], il se
fait sortir du groupe qu'il avait, une petite erreur tactique, il a flingué
le groupe pensant qu'il était plus fort ; le groupe l'a recroisé
au bout d'un moment et l'a oublié sur le bord de la route. Ça
fait qu'il arrive à trente et quelque minutes avec un mec qu'il
a repêché au bord de la route, qui était tombé,
un Generali, il était tellement cuit, rapé, qu'il est resté
dans sa roue toute la course. Ils sont rentrés dans les délais,
mais je peux vous dire que ce soir, il est très-très-très
fatigué, et sur ce qu'il a fait, pour un sprinter, y'en a beaucoup
qu'auraient mis la flèche, et qui seraient rentrés à
la maison. Ça, c'est un battant, et chapeau ! […] Y'a un
premier, y'a un dernier."
3. Bourgui s'adresse au public, d'abord pour lui recommander la prudence
au bord des routes, puis surtout pour le remercier de ses encouragements.
Par exemple, après la fameuse chute du passage du Goix :
"J'ai vu des gamelles, j'ai vu des caméscopes qui restent
comme des cons au milieu. […] Ils ne se rendent pas compte. Un vélo,
c'est un vélo, ça n'a pas de moteur, donc ils n'ont pas
peur de ça. On rentre pas sur le court de tennis, y'a des limites
sur le court de tennis. Nous, notre limite, c'est le goudron, c'est même
pas les pointillés. Quand y'a un parking, on essaye de passer sur
le parking si y'a de la bordure. […] On peut être aussi dangereux
qu'une bagnole de course, parce que si on tape une personne, un gamin,
on peut le laisser raide au bord de la route, et ça, moi, ça
me casserait mon Tour, et même ma carrière."
4. Bourgui raconte des faits de course, des anecdotes bien fraîches.
Par exemple, après l'étape Nantes-Laval de la première
semaine :
"Y'a une cinquantaine de mecs qui se sont arrêtés
pour pisser, et, comme il n'y a plus de patron, et comme il n'y a plus
de loi dans le cyclisme actuel, et là ça me fout vraiment
les boules, parce que sur chute on attaque, sur pause pipi on attaque,
et y'a Conti, qui porte bien son nom, eh bien il a attaqué au départ.
Et voilà ! lui, je lui mets le bonnet d'âne pour la semaine,
même peut-être pour le Tour."
5. Bourgui disserte sur le vélo en général, avec
parfois des explications techniques.
Par exemple, après l'étape Laval-Blois, durant laquelle
le record de vitesse avait été battu :
"Les mecs, ils me font marrer. Parce que, quand c'est eux qui
attaquent, ils te demandent pas la permission, et quand eux ils ont mal
aux jambes, ils demandent la permission d'arrêter. C'est vrai qu'il
y a des moments où on aimerait bien que ça fasse un break,
bon ben y'a des mecs qui veulent pas, bon tant pis, on essaie d'aller
les chercher ou on les laisse partir. Les laisser partir, c'est con, parce
qu'ils vont gagner, et si on va les chercher, c'est con aussi, parce que
ça fait mal aux jambes."
6. Bourgui analyse l'étape à venir, et fait preuve d'un
certain flair dans ses pronostics.
Par exemple, dès le prologue, je parie sur Armstrong :
"Sur le Dauphiné, on a vu que, bon, il avait loupé
le coup où j'étais dans l'échappée, qu'y avait
son petit cow-boy devant, mais sinon, c'est lui qui gagnait. Route du
Sud, impressionnant de facilité ! On voyait qu'il montait en pression,
et que ça allait être l'homme du Tour. […] Il s'est
forgé un moral. C'est vrai que ça a dû être
très-très dur, pour lui, parce qu'il est passé près
de la mort, il faut le dire, mais il s'est battu, il a montré qu'il
en avait, il voulait montrer qu'il n'était pas fini, et on dit
chapeau, je ne peux dire que chapeau. Armstrong vainqueur ? Ouais, ouais."
7. Bourgui balance des vannes diverses.
Par exemple, après mon échappée dans l'Alpe-d'Huez :
"C'est bien le vélo quand on est fort. […] Bien sûr,
on peut avoir de la suspicion sur tout. […] Le vieux, comment il
fait ? Eh bien Viagra, avec Viagra tout va. Et voilà ! Trois Viagra
par jour, et puis j'en ai pris deux en course, et ça va vachement
bien. Bon, c'est un peu gênant, c'est un peu gênant dans le
cuissard, mais ça va bien. Fallait y penser. Y'en a qui y ont peut-être
pensé, mais pas osé."
Sept thèmes, comme il y a sept jours dans la semaine, sept péchés
capitaux, sept visions de saint Jean, sept têtes au dragon de l'Apocalypse... |
|
[ suite dans le livre : 14 pages… ] |
|
| Épilogue |
Quand nous discutons ensemble, le coureur Pascal Lino, qui est un
ami, me dit parfois : "Ton accident, tes gamelles, tes galères,
je crois que si j'avais rencontré le dixième de tes problèmes,
j'aurais dix fois arrêté ma carrière."
On ne choisit pas son sport.
J'étais un excellent skieur ; pourtant, me lancer dans le ski
de compétition ne m'a jamais tenté. Et puis, à 23
ans, par curiosité, j'ai disputé une course de cyclotouriste...
À peine avais-je franchi la ligne d'arrivée que j'essayais
de me renseigner sur les épreuves auxquelles il était possible
de s'inscrire pour le week-end prochain.
Le vélo est un sport mécanique. Il y a cette petite machine,
si simple, si légère, si précise, qui nous emmène
tellement vite : facilement 60 à 70 km/h sur le plat, dans le silence,
à la seule force des jarrets, jusqu'à 110 km/h (mon record)
en descente.
En descente, dans les virages, nous allons plus vite que les motos
; nous prenons plus d'angle ; elles doivent accélérer en
ligne droite pour nous rejoindre. La descente, c'est du pilotage.
Souvent, les gens nous demandent à quoi nous pensons quand nous
escaladons des cols ; personnellement, je ne pense à rien, si ce
n'est aux écarts avec les autres coureurs, à mon rythme,
à la gestion de mon effort ; je suis entièrement concentré
sur mon exercice.
La compétition est un jeu. En course, je m'amuse comme un gamin.
Le vélo est un sport foncièrement individuel, mais dans
lequel le collectif joue un rôle primordial. Sous ce rapport, j'ai
beau chercher, je ne vois pas d'équivalent dans les autres disciplines.
Les spectateurs qui nous voient souffrir ont du mal à le comprendre,
mais, quelque part, nous sommes dans notre élément. La douleur
est présente, mais ce n'est pas l'agonie que peuvent connaître
les cyclistes du dimanche. Nous sommes préparés pour l'affronter.
En plus, il paraît que nous sommes un peu accros : la douleur libère
des analgésiques naturels, les endomorphines. Nous sommes peut-être
aussi un peu maso ; sado-maso, car il s'agit également de faire
mal aux autres. Il est médicalement prouvé que le cyclisme
est le sport où l'organisme se dépasse le plus ; car, en
nous portant, la machine nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes.
Même en compétition, l'œil est attiré par un paysage,
une enfilade d'arbres, les couleurs d'un champ, un groupe de maisons ;
les beautés de la nature et de l'architecture. Avec les centaines
de milliers de kilomètres que j'ai parcourus en course ou à
l'entraînement, je pense connaître les Alpes, les Pyrénées
où le Vaucluse mieux que les habitants qui y vivent depuis leur
naissance.
Chaque année, mon corps vit plusieurs saisons. Après
la coupure de novembre, je suis un peu empâté ; la reprise
est laborieuse. En avril, le moteur commence à bien fonctionner
; en juin, il est de nouveau débridé. Le même col
où je piochais en mars, je le survole en juillet. Cette impression
de facilité est toujours grisante. Je connais beaucoup de professionnels
qui ne sont plus remontés sur un vélo une fois leur carrière
achevée, car ils ne pouvaient pas supporter la perte de leur aisance
d'antan. Aujourd'hui, je suis incapable de dire si je continuerai à
rouler après avoir quitté le peloton.
La passion est devenue un métier. Ce métier m'a permis
de gagner un peu d'argent, de beaucoup voyager, de rencontrer des personnes
de tous les milieux.
L'une des forces immenses du cyclisme, c'est la proximité du
public. Du bord de la route, les gens nous voient passer à quelques
centimètres. Et le spectacle est gratuit.
Dès ma première année de professionnel, j'ai su
que je ne serai pas un nouveau Bernard Hinault. J'arrivais trop tard,
et, sans fausse modestie, il me manquait la grande classe. Mais j'ai toujours
essayé de gagner des courses ; et j'en ai gagné quelques-unes.
J'ai été généreux dans l'effort, curieusement
souvent plus pour mes leaders que pour moi-même. Mon parcours fut
solide et honnête, au plus haut niveau pendant une grosse dizaine
d'années. Si j'avais pu choisir, j'aurais préféré
être rouleur-sprinter plutôt que rouleur-grimpeur, car mon
palmarès aurait été plus étoffé.
Je ne me prends pas au sérieux, et j'ai été sérieux.
La reconversion, ce sera sans doute dans le vélo, encore que
je n'en sois pas tout à fait sûr. Dans le vélo, mais
peut-être pas avec des responsabilités sportives directes.
J'ai envie de m'essayer à d'autres métiers que celui de
directeur sportif ou d'entraîneur.
J'aimerais que mon fils fasse du sport ; pas forcément du vélo,
pas forcément de la haute compétition, mais qu'il pratique
un sport, n'importe lequel.
Le sport est une école de la vie. Et, selon l'adage, la vie
n'est pas bonne, mais elle est belle. |
|
|
| Cahier photos : Album personnel |
|
| (Cliquez sur la photo pour la faire apparaître agrandie dans une nouvelle fenêtre) |
|
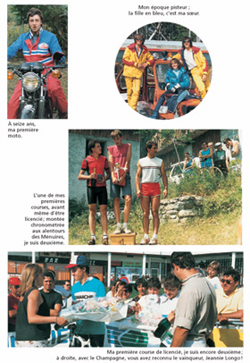 |
|
 |
|
| Page 5 du cahier "Album personnel " |
|
Page 8 du cahier "Album personnel" |
|
| [ suite dans le livre : 16 pages… ] |
|
|
| Cahier photos : Travail d'équipe |
|
| (Cliquez sur la photo pour la faire apparaître agrandie dans une nouvelle fenêtre) |
|
 |
|
 |
|
| Page 7 du cahier "Travail d'équipel" |
|
Page 9 du cahier "Travail d'équipe" |
|
| [ suite dans le livre : 16 pages… ] |
|
|
|
|
|
|